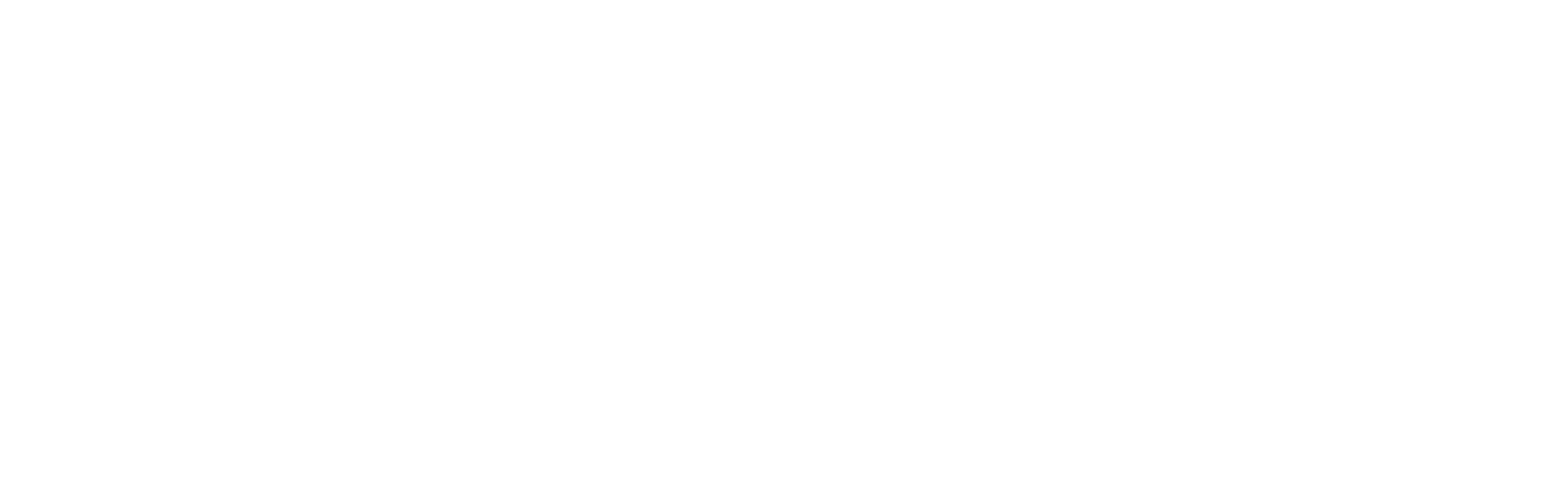05 Août MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS (2014)
Posted at 00:00h
in
by mr_admin
Chers frères et sœurs !
Nos sociétés font l’expérience, comme cela n’est jamais arrivé auparavant dans
l’histoire, de processus d’interdépendance mutuelle et d’interaction au niveau
mondial, qui, s’ils comprennent aussi des éléments problématiques ou négatifs, ont
pour objectif d’améliorer les conditions de vie de la famille humaine, non seulement
dans ses aspects économiques, mais aussi dans ses aspects politiques et culturels.
Du reste, chaque personne appartient à l’humanité et partage l’espérance d’un
avenir meilleur avec toute la famille des peuples. De cette constatation est né le
thème que j’ai choisi pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié de cette
année: « Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur ».
Parmi les résultats des mutations modernes, le phénomène croissant de la mobilité
humaine émerge comme un « signe des temps » ; ainsi l’a défini le Pape Benoît XVI
(cf. Message pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2006). Si d’une
part, en effet, les migrations trahissent souvent des carences et des lacunes des
États et de la Communauté internationale, de l’autre elles révèlent aussi l’aspiration
de l’humanité à vivre l’unité dans le respect des différences, l’accueil et l’hospitalité
qui permettent le partage équitable des biens de la terre, la sauvegarde et la
promotion de la dignité et de la centralité de tout être humain.
Du point de vue chrétien, aussi bien dans les phénomènes migratoires, que dans
d’autres réalités humaines, se vérifie la tension entre la beauté de la création,
marquée par la Grâce et la Rédemption, et le mystère du péché. À la solidarité et à
l’accueil, aux gestes fraternels et de compréhension, s’opposent le refus, la
discrimination, les trafics de l’exploitation, de la souffrance et de la mort. Ce sont
surtout les situations où la migration n’est pas seulement forcée, mais même
réalisée à travers diverses modalités de traite des personnes et de réduction en
esclavage qui causent préoccupation. Le « travail d’esclave » est aujourd’hui
monnaie courante ! Toutefois, malgré les problèmes, les risques et les difficultés à
affronter, ce qui anime de nombreux migrants et réfugiés c’est le binôme confiance
et espérance ; ils portent dans leur cœur le désir d’un avenir meilleur non
seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles et pour les personnes
qui leur sont chères.
Que comporte la création d’un « monde meilleur » ? Cette expression ne fait pas
allusion naïvement à des conceptions abstraites ou à des réalités hors d’atteinte,
mais oriente plutôt à la recherche d’un développement authentique et intégral, à
travailler pour qu’il y ait des conditions de vie dignes pour tous, pour que les
exigences des personnes et des familles trouvent de justes réponses, pour que la
création que Dieu nous a donnée soit respectée, gardée et cultivée. Le Vénérable
Paul VI décrivait avec ces mots les aspirations des hommes d’aujourd’hui : « être
affranchis de la misère, trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi
stable ; participer davantage aux responsabilités, hors de toute oppression, à l’abri
14
des situations qui offensent leur dignité d’hommes ; être plus instruits ; en un mot,
faire, connaître, et avoir plus, pour être plus » (Lett. enc. Populorum progressio, 26
mars 1967, n. 6).
Notre cœur désire un « plus » qui n’est pas seulement un connaître plus ou un avoir
plus, mais qui est surtout un être plus. Le développement ne peut être réduit à la
simple croissance économique, obtenue, souvent sans regarder aux personnes plus
faibles et sans défense. Le monde peut progresser seulement si l’attention première
est dirigée vers la personne ; si la promotion de la personne est intégrale, dans
toutes ses dimensions, incluse la dimension spirituelle ; si personne n’est délaissé,
y compris les pauvres, les malades, les prisonniers, les nécessiteux, les étrangers
(cf. Mt 25, 31-46); si on est capable de passer d’une culture du rejet à une culture
de la rencontre et de l’accueil.
Migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur l’échiquier de l’humanité. Il s’agit
d’enfants, de femmes et d’hommes qui abandonnent ou sont contraints
d’abandonner leurs maisons pour diverses raisons, et qui partagent le même désir
légitime de connaître, d’avoir mais surtout d’être plus. Le nombre de personnes qui
émigrent d’un continent à l’autre, de même que celui de ceux qui se déplacent à
l’intérieur de leurs propres pays et de leurs propres aires géographiques, est
impressionnant. Les flux migratoires contemporains constituent le plus vaste
mouvement de personnes, sinon de peuples, de tous les temps. En marche avec les
migrants et les réfugiés, l’Église s’engage à comprendre les causes qui sont aux
origines des migrations, mais aussi à travailler pour dépasser les effets négatifs et à
valoriser les retombées positives sur les communautés d’origine, de transit et de
destination des mouvements migratoires.
Malheureusement, alors que nous encourageons le développement vers un monde
meilleur, nous ne pouvons pas taire le scandale de la pauvreté dans ses diverses
dimensions. Violence, exploitation, discrimination, marginalisation, approches
restrictives aux libertés fondamentales, aussi bien des individus que des
collectivités, sont quelques-uns des principaux éléments de la pauvreté à vaincre.
Bien des fois justement ces aspects caractérisent les déplacements migratoires,
liant migrations et pauvreté. Fuyant des situations de misère ou de persécution
vers des perspectives meilleures, ou pour avoir la vie sauve, des millions de
personnes entreprennent le voyage migratoire et, alors qu’elles espèrent trouver la
réalisation de leurs attentes, elles rencontrent souvent méfiance, fermeture et
exclusion et sont frappées par d’autres malheurs, souvent encore plus graves et qui
blessent leur dignité humaine.
La réalité des migrations, avec les dimensions qu’elle présente en notre époque de
la mondialisation, demande à être affrontée et gérée d’une manière nouvelle,
équitable et efficace, qui exige avant tout une coopération internationale et un
esprit de profonde solidarité et de compassion. La collaboration aux différents
niveaux est importante, avec l’adoption, par tous, des instruments normatifs qui
protègent et promeuvent la personne humaine. Le Pape Benoît XVI en a tracé les
lignes en affirmant qu’« une telle politique doit être développée en partant d’une
étroite collaboration entre les pays d’origine des migrants et les pays où ils se
rendent ; elle doit s’accompagner de normes internationales adéquates, capables
d’harmoniser les divers ordres législatifs, dans le but de sauvegarder les exigences
et les droits des personnes et des familles émigrées et, en même temps, ceux des
sociétés où arrivent ces mêmes émigrés » (Lett. enc. Caritas in veritate, 29 juin
15
2009, n. 62). Travailler ensemble pour un monde meilleur réclame une aide
réciproque entre pays, avec disponibilité et confiance, sans élever de barrières
insurmontables. Une bonne synergie peut encourager les gouvernants pour
affronter les déséquilibres socioéconomiques et une mondialisation sans règles, qui
font partie des causes des migrations dans lesquelles les personnes sont plus
victimes que protagonistes. Aucun pays ne peut affronter seul les difficultés liées à
ce phénomène, qui est si vaste qu’il concerne désormais tous les continents dans le
double mouvement d’immigration et d’émigration.
Il est important, ensuite, de souligner comment cette collaboration commence déjà
par l’effort que chaque pays devrait faire pour créer de meilleures conditions
économiques et sociales chez lui, de sorte que l’émigration ne soit pas l’unique
option pour celui qui cherche paix, justice, sécurité, et plein respect de la dignité
humaine. Créer des possibilités d’embauche dans les économies locales, évitera en
outre la séparation des familles, et garantira les conditions de stabilité et de
sérénité, à chacun et aux collectivités.
Enfin, regardant la réalité des migrants et des réfugiés, il y a un troisième élément
que je voudrais mettre en évidence sur le chemin de la construction d’un monde
meilleur ; c’est celui du dépassement des préjugés et des incompréhensions dans la
manière dont on considère les migrations. Souvent, en effet, l’arrivée de migrants,
de personnes déplacées, de demandeurs d’asile et de réfugiés suscite chez les
populations locales suspicion et hostilité. La peur nait qu’il se produise des
bouleversements dans la sécurité de la société, que soit couru le risque de perdre
l’identité et la culture, que s’alimente la concurrence sur le marché du travail, ou
même, que soient introduits de nouveaux facteurs de criminalité. Les moyens de
communication sociale, en ce domaine ont une grande responsabilité : il leur
revient, en effet, de démasquer les stéréotypes et d’offrir des informations
correctes où il arrivera de dénoncer l’erreur de certains, mais aussi de décrire
l’honnêteté, la rectitude et la grandeur d’âme du plus grand nombre. En cela, un
changement d’attitude envers les migrants et les réfugiés est nécessaire de la part
de tous ; le passage d’une attitude de défense et de peur, de désintérêt ou de
marginalisation – qui, en fin de compte, correspond à la « culture du rejet » – à une
attitude qui ait comme base la « culture de la rencontre », seule capable de
construire un monde plus juste et fraternel, un monde meilleur. Les moyens de
communication, eux aussi, sont appelés à entrer dans cette « conversion des
attitudes » et à favoriser ce changement de comportement envers les migrants et
les réfugiés.
Je pense aussi à la manière dont la Sainte Famille de Nazareth a vécu l’expérience
du refus au début de sa route : Marie « mit au monde son fils premier né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune » (Lc 2,7). Plus encore, Jésus, Marie et Joseph ont fait
l’expérience de ce que signifie laisser sa propre terre et être migrants : menacés
par la soif de pouvoir d’Hérode, ils ont été contraints de fuir et de se réfugier en
Égypte (cf. Mt 2, 13-14). Mais le cœur maternel de Marie et le cœur prévenant de
Joseph, Gardien de la Sainte Famille, ont toujours gardé la confiance que Dieu ne
les abandonnerait jamais. Par leur intercession, que cette même certitude soit
toujours ferme, dans le cœur du migrant et du réfugié.
En répondant au mandat du Christ « Allez, et de toutes les nations faites des
disciples », l’Église est appelée à être le Peuple de Dieu qui embrasse tous les
16
peuples, et qui porte à tous les peuples l’annonce de l’Évangile, puisque, sur le
visage de toute personne est imprimé le visage du Christ ! Là se trouve la racine la
plus profonde de la dignité de l’être humain, qui est toujours à respecter et à
protéger. Ce ne sont pas tant les critères d’efficacité, de productivité, de classe
sociale, d’appartenance ethnique ou religieuse qui fondent la dignité de la
personne, mais le fait d’être créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1,
26-27), et plus encore le fait d’être enfants de Dieu ; tout être humain est enfant
de Dieu ! L’image du Christ est imprimée en lui ! Il s’agit alors de voir, nous d’abord
et d’aider ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non pas
seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à
respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la
construction d’une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus
solidaire, un monde plus fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte,
selon l’Évangile. Les migrations peuvent faire naître la possibilité d’une nouvelle
évangélisation, ouvrir des espaces à la croissance d’une nouvelle humanité,
annoncée par avance dans le mystère pascal : une humanité pour laquelle toute
terre étrangère est une patrie et toute patrie est une terre étrangère.
Chers migrants et réfugiés ! Ne perdez pas l’espérance qu’à vous aussi est réservé
un avenir plus assuré, que sur vos sentiers vous pourrez trouver une main tendue,
qu’il vous sera donné de faire l’expérience de la solidarité fraternelle et la chaleur
de l’amitié ! À vous tous et à ceux qui consacrent leur vie et leurs énergies à vos
côtés, je vous assure de ma prière et je vous donne de tout cœur la Bénédiction
apostolique.