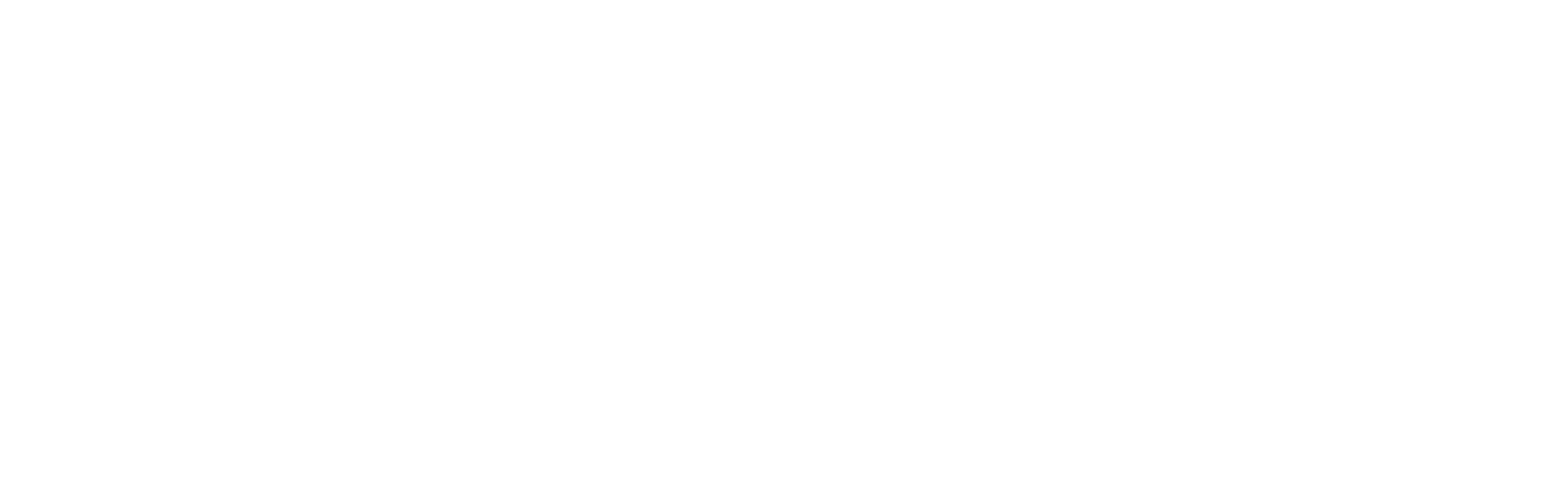21 Fév DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS AU FORUM INTERNATIONAL « MIGRATIONS ET PAIX »
Mesdames et Messieurs,
J’adresse à chacun de vous mes salutations cordiales, ainsi qu’une sincère gratitude
pour votre précieux travail. Je remercie Mgr Tomasi pour ses aimables paroles et M.
Pöttering pour son intervention; je suis également reconnaissant pour les trois
témoignages qui représentent concrètement le thème de ce forum: «Intégration et
développement: de la réaction à l’action». En effet, il n’est pas possible de lire les
défis actuels des mouvements migratoires contemporains et de la construction de la
paix sans inclure le binôme «développement et intégration»: c’est dans ce but que
j’ai voulu instituer le Dicastère pour le service du développement humain intégral, à
l’intérieur duquel une section s’occupe spécifiquement de ce qui concerne les
migrants, les réfugiés et les victimes de la traite.
Les migrations, dans leurs différentes formes, ne représentent certes pas un
phénomène nouveau dans l’histoire de l’humanité. Elles ont profondément marqué
chaque époque, favorisant la rencontre des peuples et la naissance de nouvelles
civilisations. Dans son essence, migrer est l’expression du désir intrinsèque de
bonheur propre à tout être humain, un bonheur qui doit être recherché et poursuivi.
Pour nous, chrétiens, toute la vie terrestre est un itinéraire vers notre patrie
céleste.
Le début de ce troisième millénaire est fortement caractérisé par des mouvements
migratoires qui, en termes d’origine, de transit et de destination, concernent
pratiquement toutes les régions de la terre. Malheureusement, dans une grande
partie des cas, il s’agit de déplacements forcés, causés par des conflits, des
catastrophes naturelles, des persécutions, des changements climatiques, des
violences, une pauvreté extrême et des conditions de vie indignes: «Le nombre de
personnes qui émigrent d’un continent à l’autre, de même que celui de ceux qui se
déplacent à l’intérieur de leurs propres pays et de leurs propres aires
géographiques, est impressionnant. Les flux migratoires contemporains constituent
le plus vaste mouvement de personnes, sinon de peuples, de tous les temps»(1).
Face à ce scénario complexe, je sens le devoir d’exprimer une préoccupation
particulière pour la nature forcée de nombreux flux migratoires contemporains, qui
augmente les défis à la communauté politique, à la société civile et à l’Eglise et qui
exige que l’on réponde de façon encore plus urgente à ces défis de manière
coordonnée et efficace.
Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes: accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer.
Accueillir: «Il y a un caractère de refus qui nous rapproche, qui nous conduit à ne
pas regarder le prochain comme un frère à accueillir, mais à le laisser hors de notre
horizon personnel de vie, à le transformer plutôt en un concurrent, en un sujet à
dominer»(2). Devant ce caractère de refus, enraciné, en ultime analyse, dans
l’égoïsme et amplifié par des démagogies populistes, un changement d’attitude est
urgent, pour surmonter l’indifférence et préférer aux craintes une attitude
généreuse d’accueil envers ceux qui frappent à nos portes. Pour ceux qui fuient les
guerres et de terribles persécutions, souvent pris au pièges dans les filets
308
d’organisations criminelles sans scrupules, il faut ouvrir des canaux humanitaires
accessibles et sûrs. Un accueil responsable et digne de nos frères et sœurs
commence en leur donnant un premier hébergement dans des espaces adéquats et
décents. Les grands rassemblements de demandeurs d’asile et de réfugiés n’ont
pas donné de résultats positifs, mais ont plutôt donné lieu à de nouvelles situations
de vulnérabilité et de malaise. Les programmes d’accueil diffus, déjà lancés dans
différentes localités, semblent au contraire faciliter la rencontre personnelle,
permettre une meilleure qualité des services et offrir de plus grandes garanties de
succès.
Protéger. Mon prédécesseur, le Pape Benoît, a souligné que l’expérience migratoire
rend souvent les personnes plus vulnérables à l’exploitation, à l’abus et à la
violence(3). Nous parlons de millions de travailleurs, hommes et femmes, migrants
— et parmi ceux-ci, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière — de
réfugiés et de demandeurs d’asile, de victimes de la traite. La défense de leurs
droits inaliénables, la garantie des libertés fondamentales et le respect de leur
dignité sont des devoirs dont personne ne peut se dispenser. Protéger ces frères et
sœurs est un impératif moral à traduire en adoptant des instruments juridiques,
internationaux et nationaux, clairs et pertinents; en effectuant des choix politiques
justes et clairvoyants, en préférant les processus constructifs, sans doute plus
lents, aux retours de consensus immédiats; en mettant en œuvre des programmes
opportuns et humanisants dans la lutte contre les «trafiquants de chair humaine»
qui font du profit sur les malheurs d’autrui; en coordonnant les efforts de tous les
acteurs, parmi lesquels, vous pouvez en être certains, il y aura toujours l’Eglise.
Promouvoir. Protéger ne suffit pas, il faut promouvoir le développement humain
intégral des migrants, des déplacés et des réfugiés, qui «se réalise à travers le soin
que l’on porte aux biens incommensurables de la justice, de la paix et de la
sauvegarde de la création»(4). Le développement, selon la doctrine sociale de
l’Eglise(5), est un droit indéniable de tout être humain. En tant que tel, il doit être
garanti en assurant les conditions nécessaires pour son exercice, aussi bien dans le
domaine individuel que dans le domaine social, en donnant à tous un accès égal
aux biens fondamentaux et en offrant des possibilités de choix et de croissance. Là
aussi, une action coordonnée et prévoyante de toutes les forces en jeu est
nécessaire: de la communauté politique à la société civile, des organisations
internationales aux institutions religieuses. La promotion humaine des migrants et
de leurs familles commence par les communautés d’origine, là où doit être garanti,
avec le droit de pouvoir émigrer, également le droit de ne pas devoir émigrer(6),
c’est-à-dire le droit de trouver dans sa patrie des conditions qui permettent une
réalisation digne de l’existence. A cette fin, il faut encourager les efforts qui
conduisent à la mise en œuvre de programmes de coopération internationale,
détachés de tout intérêt partisan, et de développement transnational dans lesquels
les migrants sont impliqués comme protagonistes.
Intégrer. L’intégration, qui n’est ni assimilation ni incorporation, est un processus
bidirectionnel, qui se fonde essentiellement sur la reconnaissance mutuelle de la
richesse culturelle de l’autre: ce n’est pas l’aplatissement d’une culture sur l’autre,
ni un isolement réciproque, avec le risque de «ghettoïsations» aussi néfastes que
dangereuses. En ce qui concerne celui qui arrive et qui est tenu de ne pas se fermer
à la culture et aux traditions du pays d’accueil, en respectant avant tout ses lois, il
ne faut absolument pas négliger la dimension familiale du processus d’intégration:
309
c’est pourquoi je me sens le devoir de redire la nécessité, plusieurs fois soulignée
par le Magistère(7), de politiques visant à favoriser et à privilégier les
regroupements familiaux. En ce qui concerne les populations autochtones, il faut les
aider en les sensibilisant de façon adéquate et en les disposant de façon positive
aux processus d’intégration, pas toujours simples et immédiats, mais toujours
essentiels et incontournables pour l’avenir. Il faut aussi pour cela des programmes
spécifiques qui favorisent la rencontre significative avec l’autre. Pour la
communauté chrétienne, ensuite, l’intégration pacifique de personnes de cultures
différentes est, en quelque sorte, également un reflet de sa catholicité, étant donné
que l’unité, qui n’annule pas les différences ethniques et culturelles, constitue une
dimension de la vie de l’Eglise qui, dans l’Esprit de la Pentecôte, est ouverte à tous
et désire embrasser chacun(8).
Je crois que conjuguer ces quatre verbes, à la première personne du singulier et à
la première personne du pluriel, représente aujourd’hui un devoir, un devoir à
l’égard de frères et sœurs qui, pour des raisons diverses, sont forcés de quitter leur
lieu d’origine: un devoir de justice, de civilisation et de solidarité.
Avant tout, un devoir de justice. Les inégalités économiques inacceptables, qui
empêchent de mettre en pratique le principe de la destination universelle des biens
de la terre, ne sont plus durables. Nous sommes tous appelés à entreprendre des
processus de partage respectueux, responsable et inspiré par les préceptes de la
justice distributive. «Il est donc nécessaire de trouver les moyens pour que tous
puissent bénéficier des fruits de la terre, non seulement pour éviter que s’élargisse
l’écart entre celui qui a plus et celui qui doit se contenter des miettes, mais aussi et
surtout en raison d’une exigence de justice, d’équité et de respect envers tout être
humain»(9). Un petit groupe d’individus ne peut contrôler les ressources de la
moitié du monde. Des personnes et des peuples entiers ne peuvent n’avoir le droit
que de ramasser les miettes. Et personne ne peut se sentir tranquille et dispensé
des impératifs moraux qui découlent de la coresponsabilité dans la gestion de la
planète, une coresponsabilité plusieurs fois rappelée par la communauté politique
internationale, ainsi que par le Magistère(10). Cette coresponsabilité doit être
interprétée en accord avec le principe de subsidiarité «qui donne la liberté au
développement des capacités présentes à tous les niveaux, mais qui exige en
même temps plus de responsabilité pour le bien commun de la part de celui qui
détient plus de pouvoir»(11). Faire justice signifie également réconcilier l’histoire
avec le présent mondialisé, sans perpétuer les logiques d’exploitation de personnes
et de territoires, qui répondent à l’usage le plus cynique du marché, pour
augmenter le bien-être d’un petit nombre. Comme l’a affirmé le Pape Benoît, le
processus de décolonisation a été retardé «aussi bien à cause de nouvelles formes
de colonialisme et de dépendance à l’égard d’anciens comme de nouveaux pays
dominants, qu’en raison de graves irresponsabilités internes aux pays devenus
indépendants»(12). Il faut remédier à tout cela.
En second lieu, il y a un devoir de civilisation. Notre engagement en faveur des
migrants, des déplacés et des réfugiés est une application de ces principes et
valeurs d’accueil et de fraternité qui constituent un patrimoine commun d’humanité
et de sagesse auquel puiser. Ces principes et ces valeurs ont été codifiés au cours
de l’histoire dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans de
nombreuses conventions et accords internationaux. «Tout migrant est une
personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux
310
inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toute circonstance»(13).
Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de réaffirmer le caractère central de
la personne humaine, sans permettre que des conditions contingentes et
accessoires, ainsi que le respect nécessaire de conditions bureaucratiques ou
administratives, n’en obscurcissent la dignité essentielle. Comme l’a déclaré saint
Jean-Paul II, «la situation d’irrégularité juridique n’autorise pas à négliger la dignité
du migrant, qui possède des droits inaliénables, qui ne peuvent être ni violés ni
ignorés»(14). Par devoir de civilisation, il faut également retrouver la valeur de la
fraternité qui se fonde sur la constitution relationnelle native de l’être humain: «La
vive conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne
comme une vraie sœur et un vrai frère; sans cela, la construction d’une société
juste, d’une paix solide et durable devient impossible»(15). La fraternité est la
manière la plus civile d’entrer en relation avec la présence de l’autre, qui ne
menace pas mais interroge, réaffirme et enrichit notre identité individuelle(16).
Il y a, enfin, un devoir de solidarité. Face aux tragédies qui «marquent au fer
rouge» la vie de tant de migrants et de réfugiés — guerres, persécutions, abus,
violence, mort — ne peuvent qu’apparaître des sentiments spontanés d’empathie et
de compassion. «Où est ton frère?» (cf. Gn 4, 9): cette question, que Dieu pose à
l’homme depuis les origines, nous concerne, en particulier, aujourd’hui, à l’égard de
nos frères et sœurs qui migrent: «Ce n’est pas une question adressée aux autres,
c’est une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous»(17). La solidarité naît
précisément de la capacité à comprendre les besoins de notre frère et de notre
sœur en difficulté et de s’en charger. C’est sur cela, en substance, que se fonde la
valeur sacrée de l’hospitalité présente dans les traditions religieuses. Pour nous,
chrétiens, l’hospitalité offerte à l’étranger qui a besoin d’un refuge est offerte à
Jésus Christ lui-même, qui s’est identifié avec l’étranger: «J’étais étranger et vous
m’avez accueilli» (Mt 25, 35). C’est un devoir de solidarité de s’opposer à la culture
du rejet et de réserver toute notre attention envers les plus faibles, pauvres et
vulnérables. C’est pourquoi «un changement d’attitude envers les migrants et les
réfugiés est nécessaire de la part de tous; le passage d’une attitude de défense et
de peur, de désintérêt ou de marginalisation — qui, en fin de compte, correspond à
la “culture du rejet” — à une attitude qui ait comme base la “culture de la
rencontre”, seule capable de construire un monde plus juste et fraternel, un monde
meilleur»(18).
En conclusion de cette réflexion, permettez-moi d’attirer votre attention sur un
groupe particulièrement vulnérable parmi les migrants, les déplacés et les réfugiés
que nous sommes appelés à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Je veux
parler des enfants et des adolescents qui sont forcés de vivre loin de leur terre
d’origine et coupés de leurs liens familiaux. C’est à eux que j’ai dédié le dernier
message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, en soulignant qu’«il
faut viser la protection, l’intégration et des solutions durables»(19).
Je suis certain que ces deux journées de travail apporteront des fruits abondants de
bonnes œuvres. Je vous assure de ma prière; et vous, s’il vous plaît, n’oubliez pas
de prier pour moi. Merci.