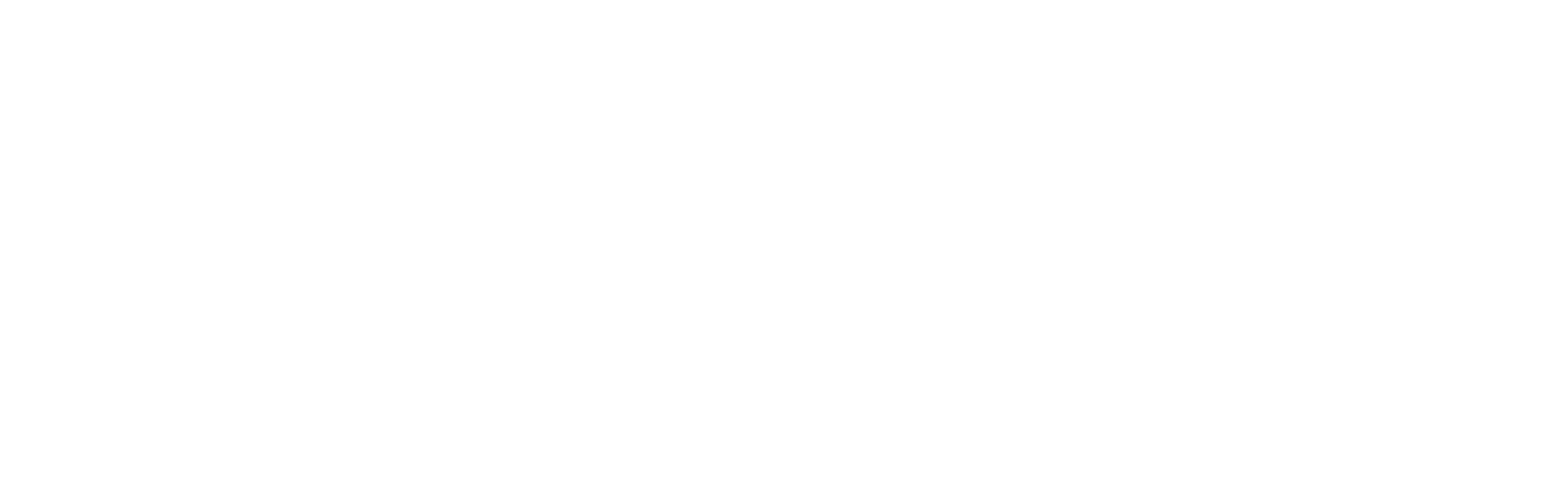27 Juil VOYAGE APOSTOLIQUE DE SA SAINTETÉ FRANÇOIS AU CANADA (24 – 30 JUILLET 2022) RENCONTRE AVEC LES AUTORITÉS CIVILES, LES REPRÉSENTANTS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LE CORPS DIPLOMATIQUE DISCOURS DU SAINT-PÈRE
Posted at 00:00h
in
by mr_admin
[…] Le Saint-Siège et les communautés catholiques locales nourrissent la volonté
concrète de promouvoir les cultures autochtones, avec des chemins spirituels
appropriés et adaptés, qui comprennent également l’attention aux traditions
culturelles, aux coutumes, aux langues et aux processus éducatifs propres, dans
l’esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones.
Notre désir est de renouveler la relation entre l’Église et les peuples autochtones du
Canada, une relation marquée à la fois par un amour qui a porté d’excellents fruits
et, malheureusement, par des blessures que nous nous engageons à comprendre et
à soigner. Je suis très reconnaissant d’avoir rencontré et écouté ces derniers mois à
Rome plusieurs représentants des peuples autochtones, et de pouvoir renforcer, ici
au Canada, les belles relations nouées avec eux. Les moments vécus ensemble ont
laissé en moi une empreinte et le désir profond de faire nôtre l’indignation et la
honte pour les souffrances subies par les autochtones, en promouvant un chemin
fraternel et patient à entreprendre avec tous les Canadiens, selon la vérité et la
justice, en œuvrant pour la guérison et la réconciliation, toujours animés par
l’espérance.
Cette « histoire de douleur et de mépris », issue d’une mentalité colonisatrice, « ne
se guérit pas facilement ». En même temps, elle nous met en garde contre le fait
que « la colonisation ne s’arrête pas, elle se transforme même en certains lieux, se
déguise et se dissimule » (Exhort. ap. Querida Amazonia, n. 16). C’est le cas des
colonisations idéologiques. Si, autrefois, la mentalité colonialiste a négligé la vie
concrète des personnes en imposant des modèles culturels préétablis, aujourd’hui
encore, des colonisations idéologiques qui s’opposent à la réalité de l’existence
étouffent l’attachement naturel aux valeurs des peuples, en essayant d’en déraciner
les traditions, l’histoire et les liens religieux, ne manquent pas. Il s’agit d’une
mentalité qui, en supposant avoir dépassé “les pages sombres de l’histoire”, fait
place à cette cancel culture qui évalue le passé uniquement sur la base de certaines
catégories actuelles. Ainsi s’implante une mode culturelle qui uniformise, rend tout
égal, ne tolère pas de différences et ne se concentre que sur le moment présent,
sur les besoins et les droits des individus, en négligeant souvent les devoirs envers
les plus faibles et les plus fragiles : les pauvres, les migrants, les personnes âgées,
les malades, les enfants à naître… Ce sont eux qui sont oubliés dans les sociétés du
bien-être ; ce sont eux qui, dans l’indifférence générale, sont jetés comme des
feuilles sèches à brûler.
Les cimes multicolores riches des arbres d’érable nous rappellent en revanche
l’importance de l’ensemble, de faire progresser des communautés humaines non
homologuées, mais réellement ouvertes et inclusives. Et comme chaque feuille est
fondamentale pour enrichir les cimes, de même chaque famille, cellule essentielle
de la société, doit être valorisée, car « l’avenir de l’humanité passe par la famille »
(S. Jean-Paul II, Exhort. ap. Familiaris consortio, n. 86). Elle est la première réalité
sociale concrète, mais elle est menacée par de nombreux facteurs : violence
domestique, frénésie professionnelle, mentalité individualiste, carriérisme effréné,
chômage, solitude des jeunes, abandon des personnes âgées et des malades… Les
peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre sur la garde et la protection
de la famille, où déjà dès l’enfance, on apprend à reconnaître ce qui est bien et ce
qui est mal, à dire la vérité, à partager, à corriger les torts, à recommencer, à se
réconforter, à se réconcilier. Que le mal subi par les peuples autochtones, et dont
nous avons honte maintenant, nous serve aujourd’hui de mise en garde, afin que le
soin et les droits de la famille ne soient pas mis de côté au nom d’éventuels
exigences productives et d’intérêts individuels.
Revenons à la feuille d’érable. En temps de guerre, les soldats en faisaient usage
comme pansements et médicaments pour les blessures. Aujourd’hui, face à la folie
insensée de la guerre, nous avons de nouveau besoin d’apaiser les extrémismes de
l’opposition et de soigner les blessures de la haine. Un témoin de violences
tragiques passées a récemment dit que « la paix a son secret : ne jamais haïr
personne. Si l’on veut vivre, il ne faut jamais haïr » (Interview d’E. Bruck, dans
“Avvenire”, 8 mars 2022). Nous n’avons pas besoin de diviser le monde en amis et
en ennemis, de prendre les distances et de nous réarmer jusqu’aux dents : ce ne
sera pas la course aux armements et les stratégies de dissuasion qui apporteront la
paix et la sécurité. Il n’est pas nécessaire de se demander comment continuer les
guerres, mais comment les arrêter. Et d’empêcher que les peuples soient de
nouveau pris en otage par l’emprise d’effrayantes guerres froides qui s’élargissent
encore. Nous avons besoin de politiques créatives et prévoyantes, qui sachent sortir
des schémas des parties, pour apporter des réponses aux défis mondiaux.
En effet, les grands défis actuels tels que la paix, les changements climatiques, les
effets pandémiques et les migrations internationales ont en commun une constante
: ils sont mondiaux, ce sont des défis mondiaux, ils concernent tout le monde. Et si
tous parlent de la nécessité de l’ensemble, la politique ne peut rester prisonnière
d’intérêts partisans. Il faut savoir regarder, comme l’enseigne la sagesse
autochtone, les sept générations futures, non pas les convenances immédiates, les
échéances électorales, le soutien des lobbies. Et valoriser aussi les désirs de
fraternité, de justice et de paix des jeunes générations. Oui, comme il est
nécessaire, pour retrouver la mémoire et la sagesse, d’écouter les personnes âgées,
ainsi pour avoir élan et avenir, il faut embrasser les rêves des jeunes. Ils méritent
un avenir meilleur que celui que nous leur préparons, ils méritent d’être impliqués
dans les choix pour la construction du présent et de l’avenir, en particulier pour la
sauvegarde de la maison commune, pour laquelle les valeurs et les enseignements
des peuples autochtones sont précieux. À ce propos, je voudrais saluer
l’engagement local louable en faveur de l’environnement. On pourrait presque dire
que les emblèmes tirés de la nature, comme le lys sur le drapeau de cette Province
du Québec, et la feuille d’érable sur celui du pays, confirment la vocation écologique
du Canada.
Lorsque la Commission spéciale a été amenée à évaluer les milliers de maquettes
parvenues pour la réalisation du drapeau national, dont beaucoup étaient envoyées
par des gens ordinaires, surprises que presque toutes contenaient précisément la
représentation de la feuille d’érable. La participation autour de ce symbole partagé
me suggère de souligner une parole fondamentale pour les Canadiens : le
multiculturalisme. Il est à la base de la cohésion d’une société aussi composite que
les couleurs variées des cimes des érables. La même feuille d’érable, avec sa
multiplicité de pointes et de bords, fait penser à une figure polyédrique et dit que
vous êtes un peuple capable d’inclure, afin que ceux qui arrivent puissent trouver
une place dans cette unité multiforme et y apporter leur contribution originale (cf.
Evangelii gaudium, n. 236). Le multiculturalisme est un défi permanent : c’est
d’accueillir et d’embrasser les différentes composantes présentes, tout en
respectant, en même temps, la diversité de leurs traditions et cultures, sans penser
que le processus soit accompli une fois pour toutes. Je salue à cet égard votre
générosité pour l’accueil de nombreux migrants ukrainiens et afghans. Mais il faut
aussi travailler pour dépasser la rhétorique de la peur à l’égard des immigrés et
pour leur donner, selon les moyens dont dispose le pays, la possibilité concrète
d’être impliqués de manière responsable dans la société. Pour ce faire, les droits et
la démocratie sont indispensables. Il est également nécessaire de faire face à la
mentalité individualiste, en rappelant que la vie commune repose sur des
présupposés que le système politique ne peut produire à lui seul. Là aussi, la
culture autochtone est d’un grand soutien pour rappeler l’importance des valeurs de
la socialisation. Et l’Église catholique de même, avec sa dimension universelle et
son soin envers les plus fragiles, avec le légitime service en faveur de la vie
humaine dans toutes ses phases, de la conception jusqu’à la mort naturelle, est
heureuse d’offrir sa contribution.
Ces jours-ci, j’ai entendu parler de nombreuses personnes dans le besoin qui
frappent aux portes des paroisses. Même dans un pays aussi développé et avancé
que le Canada, qui consacre beaucoup d’attention à l’assistance sociale, nombreux
sont les sans-abri qui comptent sur les églises et les banques alimentaires pour
recevoir aide et réconfort essentiels, qui – ne l’oublions pas – ne sont pas
seulement matériels. Ces frères et sœurs nous amènent à considérer l’urgence de
travailler pour remédier à l’injustice radicale qui pollue notre monde, dont
l’abondance des dons de la création est répartie de manière trop inégale. Il est
scandaleux que le bien-être généré par le développement économique ne profite
pas à tous les secteurs de la société. Et il est triste que ce soit précisément parmi
les autochtones que l’on enregistre souvent de nombreux taux de pauvreté,
auxquels se rattachent d’autres indicateurs négatifs, tels que le faible taux de
scolarisation, l’accès difficile au logement et à l’assistance sanitaire. Que l’emblème
de la feuille d’érable, qui apparaît habituellement sur les étiquettes des produits du
pays, soit un encouragement pour tous à faire des choix économiques et sociaux
visant au partage et au soin des nécessiteux.
C’est en travaillant d’un commun accord, ensemble, que l’on affronte les défis
pressants d’aujourd’hui. Je vous remercie de l’hospitalité, de l’attention et de
l’estime, en vous disant avec une affection sincère que le Canada et ses habitants
me tiennent vraiment à cœur.